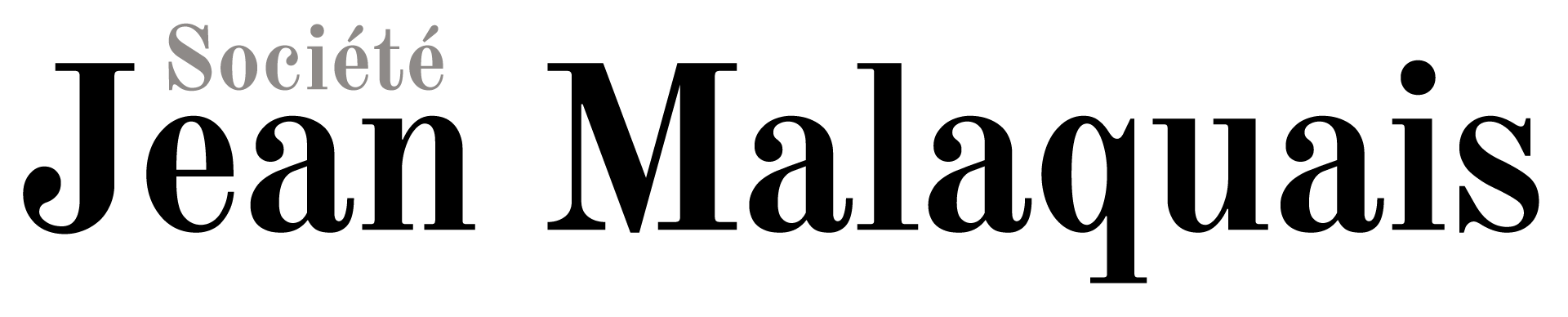Cela fait des années que j’enseigne en lycée. Il me semblait évident, lorsque j’ai commencé mes recherches sur Jean Malaquais, de faire partager mes lectures à mes élèves. Mais l’enseignement des lettres est devenu, comme on le sait, de plus en plus contraint. Les « programmes » obligent en effet à ranger les œuvres littéraires dans ce qu’il est convenu d’appeler des « objets d’étude ».
« Je n’enseigne pas, je raconte »
Michel de Montaigne
À la fin des années quatre-vingt-dix, lorsque j’ai entrepris le DEA puis l’écriture de ma thèse, le seul « objet d’étude » qui rendait possible le travail sur les œuvres de Jean Malaquais se rangeait dans la catégorie de « l’écriture autobiographique ». J’avais donc donné à lire à une classe de première Le Journal de guerre. J’enseignais alors au lycée Fresnel, spécialisé dans l’optique, dans le 15ème arrondissement de Paris. Mes élèves, peu calés en histoire, avaient peiné à trouver leurs marques. Il avait fallu leur expliquer ce qu’avaient été « la drôle de guerre », la débâcle et l’exode. Une fois ces difficultés franchies, la plupart d’entre eux s’étaient montrés sensibles à la tonalité d’ensemble, à la révolte de Malaquais, mais surtout aux passages poétiques charriant, malgré la période de la guerre, l’amour de la vie.
Nous avions mis en scène des passages du Journal ainsi que de la correspondance avec Gide et nous avions présenté notre travail à un public composé des parents et d’amis des élèves. Elisabeth Malaquais et Hywel Davies avaient assisté à une représentation. Un élève avait à cette occasion déclaré à Elisabeth : « Madame, nous avons beaucoup aimé lire ce que votre mari a écrit ; mais la lecture des textes n’a pas toujours été facile. D’ailleurs je voulais vous demander : lorsque votre mari parlait, tout le monde devait avoir un dictionnaire sur les genoux pour bien le comprendre, non ? » L’élève qui avait fait cette remarque était particulièrement attachant et curieux de tout ; ses parents, immigrés, parlaient mal le français ; lui, avait une telle envie de comprendre et d’étudier la littérature et les beaux textes qu’il avait travaillé « un dictionnaire sur les genoux » le lexique de Malaquais. C’est ce travail d’appropriation de la langue française par un « Conrad français » qui l’avait le plus marqué.
Raconter la condition ouvrière
En 2011, j’ai quitté le lycée Fresnel pour Victor Duruy, dans le 7ème arrondissement très chic de Paris. J’avais à cœur de raconter la condition ouvrière à mes élèves nés « avec une cuillère d’argent dans la bouche » – pour reprendre une expression chère à Malaquais quand il évoquait ces milieux-là. Un des « objets d’étude » étant le roman, je décidai de leur faire lire Les Javanais. Les échanges furent assez nourris. Des élèves furent sensibles au rythme de la phrase chez Malaquais, rythme ternaire ou syncopé, entre le jazz et la java ; d’autres au plurilinguisme, au point que l’un d’entre eux d’origine espagnole ne voulait pas traduire l’expression « Me cago in Dios » qu’un Javanais soliloque un dimanche à Java – ce qui avait provoqué un débat sur le français normatif, l’irrévérence qu’il ne faut pas confondre avec le mépris. La plupart des élèves furent marqués, je crois, par l’écriture inventive et drue des Javanais.
Elisabeth Malaquais accepta de venir discuter avec eux et l’échange révéla tout l’intérêt d’un jeune public pour notre romancier. Beaucoup de questions portèrent sur le travail de la mine et la condition des travailleurs étrangers, et aussi sur le travail de réécriture, les élèves ayant pu comparer les deux versions des passages étudiés en classe (celles de 1939 et 1995) ; leurs observations confirmaient que si certaines expressions avaient changé, le récit, lui, demeurait plus contemporain que jamais. Le pari de faire connaître notre auteur était gagné.
« Vous ferez la rencontre d’un écrivain passionnant ! »
J’en eus la confirmation à deux reprises, quelques mois et années plus tard. Un de mes élèves, qui poursuit de brillantes études en Sciences humaines aujourd’hui, faisait la promotion des classes littéraires à Duruy en disant que les futurs bacheliers auraient ainsi la chance de découvrir Jean Malaquais : « Inscrivez-vous en Première littéraire ! Vous ferez la rencontre d’un écrivain passionnant ! » Une autre élève, croisée récemment dans le quartier du lycée, qui avait suivi mon cours il y a dix ans, m’arrêta dans la rue et s’exclama : « Jean Malaquais ! Quelle découverte cela a été ! »
Les programmes ne me permettent plus d’enseigner aussi librement en classe de première. Désormais, non seulement les objets d’étude sont imposés, mais les auteurs également… J’ai donc décidé de faire découvrir Malaquais aux élèves de Terminale qui ont choisi la spécialité « Humanités, Littérature, Philosophie ». À ceux-là, j’ai donné l’année dernière un extrait de la nouvelle « Marianka » lorsque nous abordions le chapitre « Histoire et Violence ». On trouvera ci-dessous les copies de quatre élèves ainsi que l’extrait qu’ils devaient commenter. Je reproduirai quelques-unes de leurs remarques :
Un élève, particulièrement sensible à l’écriture célinienne, relevait une des différences majeures entre Malaquais et l’auteur du Voyage au bout de la nuit : « Ici, note-t-il, il n’y a pas d’esthétisation ni de voyeurisme comme nous pourrions en voir dans les œuvres de Céline ni de description qui se focalise entièrement sur les crimes sévis comme dans La Destruction des Juifs d’Europe de Raul Hilberg qui finit par nous « habituer » en quelque sorte à la violence jusqu’à en perdre conscience. Malaquais joue sur le contraste entre beauté et horreur afin de mieux dénoncer un tel acte de barbarie. En créant cet équilibre contrasté qui trouble et interpelle le lecteur, il montre qu’il est écrivain avant tout. »
Une autre, sensible aux questions sociales et politiques, conclut ainsi son devoir : « En démontrant la beauté du feu dansant dans la nuit et le tragique de la mort d’un homme dont le dernier espoir de survie est brisé, l’auteur fait ressortir la cruauté et la violence de la masse destructrice. Cet extrait montre un aspect terrible de l’homme et pousse à se questionner sur la responsabilité de chacun ainsi que sur l’origine d’une telle haine de l’autre. »
Qui dira aujourd’hui que Malaquais n’est pas contemporain ?
Ces articles pourraient également vous intéresser
Un article de notre ami Alain Paire à propos de la série « Transatlantique » évoquant Varian Fry et Mary Jane Gold.
Dans cet article, Alain Paire évoque la sérié «…
15 avril 2023
Mes 2 rencontres avec Jean Malaquais
Georges Millot nous raconte comment il a découvert l’œuvre…
30 avril 2021